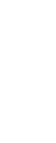
#357 - mai/juin 2021
Faut qu’on cause
Police, politiques, jeunes
#357 - mai/juin 2021
Équipements culturels et développement urbain
Les tensions sociales derrière l’injonction à “l’ancrage local”
Qu’est-ce qui se joue derrière l’implantation de nouvelles institutions culturelles dans les quartiers populaires? Ce contexte territorial spécifique a fait émerger un nouvel enjeu – devenu une quasi injonction – auprès des acteurs politiques et culturels: “l’ancrage local”. Avant d’en exposer les modalités et les tensions socio-spatiales, à l’aide des exemples forestois du Centre d’art contemporain WIELS et du centre culturel BRASS, il est nécessaire de revenir sur les conditions d’émergence de ces équipements culturels d’un nouveau genre, ainsi que sur les logiques qui motivent et justifient leur implantation1.
“Un plan d’insertion renforcé avait été mis en place en collaboration avec la mission locale, il consistait à embaucher en contrat tremplin des jeunes des quartiers. Il fallait quelqu’un qui les forme, enfin qui coordonne, leur donne des éléments de langage… un travail de médiation. […] Cela s’inscrivait dans une logique d’ancrage territorial. [Les filles des relations avec les publics lui expliquaient] comment on essayait de faire venir des publics n’ayant pas accès à la culture, par un travail de terrain auprès des acteurs locaux; Elle[s] les énumérai[ent], il y avait les centres de loisirs, les bibliothèques, les foyers d’accueil, les antennes jeunes, les MJC, la mission locale. Jeanne notait. […] Elle était comme grisée par toutes ces formules qui maintenant prenaient soudainement sens:”Je suis la clé de voûte entre la Tannerie et le quartier […]” se répéta-t-elle.” (C. Levi, La Tannerie, 2020: pp. 199-203).
Dans son dernier roman, La Tannerie, Celia Levi dépeint, à travers le regard neutre et le pas feutré de sa narratrice – jeune bretonne arrivant dans la capitale française pour se lancer dans la vie active (en l’occurrence, un emploi temporaire d’”accueillante” à la Tannerie), le fonctionnement quotidien d’une nouvelle institution artistique implantée sur une friche industrielle au bord du canal de l’Ourcq à Pantin (nord-est de Paris). Par la description détaillée de ce lieu fictif – forme cristallisée de ces nouveaux microcosmes créatifs qui émergent depuis plusieurs années dans les villes occidentales, l’auteure fait la satire d’un milieu socioprofessionnel, pris plus largement dans les contradictions d’un idéal “social-démocrate”. Parue quelques semaines après la fin de ma thèse, cette fiction a fait écho à mon travail visant à analyser, dans une posture critique et d’observateur extérieur, ce qui se joue derrière l’implantation de ce nouveau type d’équipements culturels, caractérisés par leur hybridité, dans les quartiers populaires.
La culture comme instrument de développement urbain
À partir des années 1980, à la faveur de la “marchandisation de la culture”2 et de la “compétitivité interurbaine”3 croissante, la culture s’est vue élevée au rang d’outil politique mobilisé dans les stratégies de développement urbain. Et ce, à des fins dépassant largement le champ culturel et artistique stricto sensu. Cette instrumentalisation politique de la culture est généralement motivée par deux retombées présupposées pour les villes: l’attractivité territoriale et la cohésion sociale.
Dans la littérature, deux grandes stratégies de “développement urbain par la culture” sont communément distinguées. D’une part, celle portant sur la production culturelle stimulant l’économie dite “culturelle”, à travers la planification de “districts d’industries culturelles et/ou créatives” et/ou la mise en visibilité de “quartiers d’artistes”. Et d’autre part, celle portant sur la consommation culturelle comme facteur de localisation des flux de capitaux, main-d’œuvre (qualifiée), résidents et/ou touristes (solvables), à travers l’organisation de “grands événements culturels”, en particulier via le label des “Capitales européennes de la culture”, et/ou à travers l’implantation de “grands équipements culturels”. Concernant ces derniers, nous pouvons identifier deux types d’équipements différents selon le dessein de développement (acteurs, programmations et rayonnements) dans lequel ils s’inscrivent.
Un premier modèle “exogène” émerge au cours des années 1980, fondé sur l’implantation ex nihilo de “grands équipements culturels” comme moteur d’une opération plus large de “régénération urbaine”, à savoir la reconversion postindustrielle d’une ville; et dont l’archétype reste encore aujourd’hui le Musée Guggenheim de Bilbao sur son ancien site industrialo-portuaire (1997). Du fait de son rayonnement international, ce type d’équipement culturel, dont la forme architecturale (nouvel emblème urbain) importe tout autant que son contenu (collection muséale), est conçu comme un outil de marketing urbain, c’est-à-dire un repositionnement symbolique dans la hiérarchie urbaine grâce au renforcement de l’image de marque de la ville. Ce type de développement urbain est justifié par l’argumentaire néolibéral du trickle-down effect (théorie du ruissèlement, en français), postulant que toutes les strates de la population locale finiront, de près ou de loin, par en bénéficier, notamment en matière d’emplois et/ou d’”ouverture culturelle”, et traduit dans les politiques urbaines à travers un récit autour de leurs “effets d’entrainement”.
À Bruxelles, le nouveau musée régional KANAL-Centre Pompidou – une marque mi-bruxelloise, mi-internationale – le long de l’ancien axe industriel de la ville atteste de l’actualité de ce modèle de développement urbain par la culture. Son arrivée relativement tardive, au regard des autres métropoles occidentales mais aussi des discours d’édiles locaux fantasmant depuis longtemps sur un hypothétique “effet Bilbao” à Bruxelles4, doit avant tout se comprendre par la complexité institutionnelle de la capitale belge – la séparation des compétences culturelles (Communautés) avec celles en matière d’aménagement du territoire et économiques (Région).
L’équipement culturel hybride : des logiques de production contradictoires
Face à la banalisation de ce modèle “exogène” (uniformisation des paysages urbains et de l’offre culturelle), de ses limites économiques (investissement public qui ne trickle down pas naturellement vers les populations locales), et de ses limites sociales (absence de liens avec les réseaux culturels et sociaux locaux), un nouveau type d’équipement, moins onéreux et visant un développement peu ou prou “endogène”, va voir le jour à partir des années 2000. Ces derniers ont été dénommés dans la thèse: les “équipements culturels hybrides”.
D’un point de vue géographique, à l’inverse des équipements flagship du modèle précédent – préférentiellement implantés dans l’hypercentre ou à proximité des nouvelles rentes de situation urbaine (e.g. front d’eau) de plus en plus destinés aux espaces touristiques, ces équipements culturels se caractérisent par leur localisation privilégiant des quartiers populaires péricentraux, voire périurbains, également désindustrialisés, mais densément habités (résidents et usagers). Si le CENTQUATRE à Paris (19e arrondissement) est souvent présenté, depuis son implantation en 2008 sur le site de l’ancien Service des pompes funèbres de la ville, comme l’un des archétypes de ce nouveau type d’équipements culturels. À Bruxelles, le Centre d’art contemporain WIELS, implanté en 2007 dans l’imposante salle de brassage des anciennes brasseries Wielemans-Ceuppens dans le bas de la commune de Forest, constitue certainement le cas le plus emblématique.
Malgré leur grande hétérogénéité liée aux acteurs en présence et au contexte territorial d’implantation, ces équipements se caractérisent par la multiplicité et la “multiscalarité” (différentes échelles de rayonnement) de leurs actions programmatiques. Au niveau artistique, ils visent tant la diffusion (expositions, spectacles, concerts, etc.) que la production (résidences d’artistes, ateliers créatifs, supports aux écoles d’art, etc.). Au niveau social, ils visent tant une offre socio-artistique à destination des publics du quartier les plus éloignés à ce type de culture qu’une offre payante de sensibilisation à l’art au rayonnement plus métropolitain. Enfin, au niveau urbain (et politique), ils constituent un outil de “revitalisation urbaine”, tant à travers une logique patrimoniale de réhabilitation d’édifices industriels, ecclésiastiques ou de la puissance publique d’antan, qu’à travers une logique sociale et symbolique d’animation festive du quartier (nouvelle centralité créative et ludique).
En somme, ces équipements culturels hybrides se définissent par une double logique socio-spatiale a priori contradictoire: d’un côté, et à l’instar du premier modèle, une “logique d’attractivité”, mais dont le rayonnement serait ici moins international que métropolitain, et de l’autre côté, une “logique d’ancrage local”, dont la finalité serait “l’inclusion sociale” et la “rencontre” entre des habitants économiquement, socialement et culturellement différents. Et c’est précisément par cette ambivalence qu’ils se voient assigner dans les politiques urbaines le rôle de “promoteur et gardien de la mixité sociale” des quartiers populaires alentour.
Toutefois, a contrario de cette représentation consensuelle et irénique du “développement urbain par la culture”, ma thèse avait plutôt pour hypothèse l’émergence de tensions sociales et spatiales dans le fonctionnement ambivalent de ces équipements culturels hybrides, et en particulier dans leurs relations avec les quartiers populaires en voie de gentrification5. Pour en saisir toute la mesure, il a ainsi été nécessaire d’identifier leurs dispositifs d’ancrage local pour ensuite analyser leur mise en œuvre et leurs limites.
“L’ancrage local”: modalités et tensions d’une injonction politico-morale
Si l’ensemble des cas d’étude ont pointé l’importance de s’appuyer sur le tissu associatif de “première ligne”, trois grandes modalités d’ancrage territorial ressortent plus significativement.
Face au taux de chômage élevé dans ces quartiers (en particulier, chez les jeunes), mais aussi à la violence sociale et symbolique exercée par l’offre culturelle – légitime et/ ou émergente – et les nouveaux usagers attirés par celle-ci, la première modalité constitue une offre d’emploi de gardiennage6 auprès des jeunes (bénévolat défrayé). Souvent présentée par les acteurs culturels comme une forme de relation “win-win“, à savoir une réponse à un besoin socio-économique pour les jeunes et un apaisement (préventif ou non) de leur relation avec ces derniers pour l’institution, cette démarche reste toutefois compliquée dans la pratique (distance sociale entre les acteurs culturels et les jeunes prestataires) et résonne souvent en décalage avec les discours et valeurs des acteurs culturels. En effet, ce dispositif incarnant plus généralement la “dualisation sociale” du marché de l’emploi, un secteur (vigiles) de surcroit largement racisé, contraste avec les discours d’émancipation – et à plus forte raison d’empowerment (secteur néerlandophone) – portés à l’action (socio)culturelle.
La deuxième modalité constitue l’organisation d’activités socioculturelles au sein de l’équipement en partenariat avec des associations locales. Dans les faits, deux publics cibles sont plus spécifiquement visés par ces activités7: les enfants, dans une perspective de “socialisation (à l’art) au plus jeune âge”, et les femmes issues de l’immigration, dans une perspective de support créatif aux activités développées par les associations en matière d’éducation permanente et de soutien à la parentalité. Indépendamment des effets de ces expériences sur les participants, ces activités soulignent en dernière analyse la “non mixité” des publics au sein de ces équipements. En effet, ces activités à destination de publics cibles nécessitent dans la pratique un cadre plus “intimiste et de confiance”, donnant à voir des formes de ségrégation temporelle et (micro)spatiale eu égard aux activités principales.
Sur ce point, le cas du pôle WIELS-BRASS à Forest est significatif. D’un côté, au WIELS, structure indépendante assumant implicitement la non-mixité de ses publics, les activités “kids” (payantes) à destination des enfants des classes moyennes et supérieures – mobilisant toute l’infrastructure et les espaces publics avoisinants – se distinguent des activités “socio-artistiques” (subventionnées) en collaboration avec certaines associations locales qui mobilisent, elles, pour l’essentiel une salle polyvalente en sous-sol. D’un autre côté, au centre culturel BRASS, structure plus politisée faisant de la mixité des publics son objectif cardinal, les activités de soutien à la parentalité se sont vues “victimes de leur succès” (pour reprendre les mots de son directeur) : les publics initialement fidélisés par les associations locales partenaires ont diminué à mesure que des ménages du quartier socialement mieux dotés (surtout, en capitaux culturels) s’appropriaient cette nouvelle offre.
La troisième modalité, reflétant plus spécifiquement l’ambivalence de ces équipements, constitue la programmation “hors les murs”. Celle-ci est présentée par les acteurs culturels comme un moyen de dépasser les écueils socio-symboliques associés tant à l’offre culturelle qu’à l’image de l’infrastructure (et ses usagers), mais aussi de provoquer la “rencontre” tant avec les pratiques créatives qu’entre les habitants et les visiteurs. Ce dispositif se matérialise essentiellement par le pilotage d’événements culturels (gratuits) dans l’espace public (friches, places et parcs), mobilisant une diversité d’acteurs locaux artistiques, sociaux et/ou “citoyens”. On remarquera ici que cette stratégie d’”événementalisation culturelle” est largement soutenue, si pas directement incitée, par les autorités locales, notamment dans une perspective de revalorisation symbolique du quartier8.
L’analyse de la production (partenariats) et de la consommation (fréquentation) de deux événements annuels dans le parc de Forest – le festival d’art pour enfants Supervlieg/Supermouche (WIELS/BRASS) et le festival Forest Sounds (BRASS), a montré comment ces activités culturelles “hors les murs”, à travers le “réenchantement” de l’espace public avant tout par et pour les classes moyennes et supérieures, ont tendance à normaliser socialement l’espace public, et en corollaire, à invisibiliser subtilement la vie ordinaire des classes populaires. On y observe en effet, outre des conflits d’usage (en particulier sur la friche Wielemans-Ceuppens à proximité immédiate des rues les plus populaires), des stratégies d’évitement des classes populaires, donnant à voir une ségrégation sociale à l’échelle du quartier.
Plus paradoxalement encore, ces événements semblent exacerber une forme d’assignation racialisante avec: d’une part une proportion de population racisée nettement supérieure parmi les “bénévoles-logisticiens” qu’au sein des participants et visiteurs; et d’autre part, en développant un discours suspicieux vis-à-vis de l’intégration sociale de ces derniers, comme en témoigne l’injonction à la participation de la coordinatrice des Affaires néerlandophones de la commune de Forest:“Je suis convaincue que les personnes issues de l’immigration doivent, non seulement venir aux activités, mais également s’impliquer dans les projets [culturels]”9. En définitive, si ces manifestations culturelles agissent aujourd’hui comme un outil de marketing urbain pour le bas de Forest, à savoir la mise en scène d’un quartier résidentiel socialement mixte, multiculturel, pacifié et dynamisé par une nouvelle “vie citoyenne”, il n’en reste pas moins que la promotion d’une image fantasmée ne reflète pas la réalité, comme nous l’a d’ailleurs récemment rappelée la mort du jeune Soufiane Benali10 au cœur du quartier Saint-Antoine (et non “Wiels”11).
Quand l’ancrage territorial devient vecteur de gentrification résidentielle
Les tensions socio-spatiales générées par ces équipements culturels hybrides sont inhérentes à leur fonctionnement ambivalent – attractivité et ancrage territoriaux –, et dont l’équilibre penche généralement vers la première logique. Malgré les intentions et actions d’atteindre les populations les plus éloignées à leur offre culturelle, l’ancrage local se heurte bien souvent à la réalité sociale des quartiers populaires (violence sociale et symbolique associée au décalage de cette offre vis-à-vis des besoins locaux), et complique ainsi la mise en œuvre du mot d’ordre de la “mixité sociale”.
En outre, cette logique d’ancrage territorial s’inscrit plus substantiellement dans le paradigme de la “pacification urbaine” des nouvelles politiques urbaines de “l’État social-sécuritaire”, tel que observé à Bruxelles par A. Réa (2007)12: socialisation (et parfois instrumentalisation) de groupes cibles, jeunes bénévoles-vigiles, et normalisation sociale de l’espace public. Ce faisant, dans un contexte plus large de gentrification résidentielle (e.g. le bas de Forest), ces dispositifs peuvent in fine constituer un vecteur d’ancrage à plus long terme des classes intermédiaires dans les quartiers populaires – comme un instrument d’expression et de consolidation de leur “travail de gentrification”13. Et ce, tout en assurant un outil de légitimation à l’arrivée croisée de ces nouveaux équipements et de ces nouvelles populations par la neutralisation – du moins symbolique (branding & storytelling) – des tensions sociales; et qu’un lieu culturel hors-sol (modèle exogène) peut, lui, plus difficilement masquer.
[1] Cet article est écrit à partir de ma thèse de doctorat: ““Et en plus, on travaille avec le quartier”. Analyse des tensions entre équipements culturels hybrides et quartiers populaires en voie de gentrification” (2020). L’analyse de terrain reposait sur 6 cas d’études (équipements culturels) bruxellois : dans le bas de Forest, le Centre d’art contemporain WIELS, le Centre culturel BRASS, et le futur pôle culturel ABY (abbaye de Forest), et dans le Vieux Molenbeek, le GC De Vaartkapoen, le Centre d’arts numériques iMAL (et son projet socio-éducatif CASTii), et enfin le Musée MIMA.
[2] Pour une explication courte et efficace de ce processus (et en particulier au regard des musées), voir les propos du muséologue F. Mairesse recueillis par G. Duplat, “La “marchandisation de la culture”, un grand danger ?”, dans La Libre Belgique du 30 août 2010.
[3] Pour une meilleure compréhension de ce référentiel néolibéral dans les politiques urbaines, et son application à Bruxelles, voir Van Hamme G., Van Criekingen M. (2012), “Compétitivité économique et question sociale: les illusions des politiques de développement à Bruxelles”, dans Métropoles, 11. http://journals.openedition.org/metropoles/4550.
[4] De Boeck P., (2002), “Un projet du ministre Willem Draps: un centre d’art contemporain aux brasseries Wielemans”, in Le Soir, 4 juillet 2002.
[5] Pour reprendre les mots de M. Van Criekingen dans son récent ouvrage (“Contre la gentrification”, 2021): ce sont des quartiers où habitent les classes populaires, mais qui sont aujourd’hui “sous pression” dans la mesure où ils font l’objet de nouvelles “convoitises” d’acteurs privés (spéculation foncière), d’édiles locaux (prestige métropolitain), et des classes intermédiaires à la fois dominées (division sociale et spatiale subie) et dominantes (distinction sociale et spatiale choisie).
[6] Tâches en matière de surveillance, d’accueil des visiteurs, et de soutien logistique aux événements.
[7] Ceci s’explique aussi, selon les acteurs culturels, par la grande difficulté à atteindre les adolescents, les jeunes adultes et les hommes (“les pères”) des classes populaires et issues de l’immigration.
[8] Ceci est particulièrement le cas à Forest, depuis l’arrivée en 2014 d’un nouvel échevin de la culture et de la revitalisation urbaine” (combinaison de compétences relativement rare à Bruxelles) très proactif.
[9] Propos recueillis par le RAB/BKO dans son Cahier InterAct n° 8 (2015): “Nous restons ouverts à l’inattendu – Het Lokaal cultuurbeleid à Forest: entretien avec Hilde De Visscher” (pp. 17-21).
[10] À ce propos, voir la lettre des proches de la victime envoyée à la commune, pointant les enjeux sociaux structurels du quartier Saint-Antoine, déjà dénoncés 30 ans plus tôt à la suite des dites “émeutes de Forest”. L’évolution de ces enjeux ont également été analysés 25 ans après cet événement dans un récent numéro de la revue AlterEcho: “Forest 1991, les raisons de la colère” (n°493, mai 2021).
[11] La dépossession symbolique du quartier passe également aujourd’hui par l’effacement progressif de son nom historique “Saint-Antoine” (stigmate des révoltes des années 1990) à travers la promotion de sa nouvelle image de marque “Wiels” par les nouvelles classes intermédiaires du quartier (“Quartier durable Wiels” depuis 2012), les pouvoirs publics (CQD “Wiels-sur-Senne” 2018-2022) et les promoteurs immobiliers (nouveaux projets immobiliers “à deux pas du Wiels”).
[12] Voir A. Rea (2007), “Les ambivalences de l’État social-sécuritaire”, dans Lien social et Politiques, n° 57, pp. 15-34.
[13] Cette notion désigne l’ensemble des investissements matériels, pratiques et symboliques du quartier par les nouvelles classes intermédiaires (les dits “gentrifieurs”) afin de le transformer à leur image et en ressource, aux dépens des classes populaires. Pour une explication plus détaillée, voir : Bidou-Zachariasen C. (2008). “Le “travail” de gentrification: les transformations sociologiques d’un quartier parisien populaire”. Dans Espaces et Sociétés, n°132-133: 107-124.