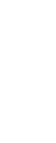
#362 - mai/juin 2022
A quoi sert (encore) l’interculturel ?
#362 - mai/juin 2022
Être Afro en Tunisie
En arabe tunisien, mnemty signifie mon rêve. Ce mot, qui fait spontanément écho au discours de Martin Luther King d’il y a quasi 60 ans, Saadia Mosbah l’a choisi pour nommer son association fondée en 2013 à Tunis. A Mnemty, on ne rêve pas entre Noirs pour les Noirs. « Dès que vous dites “mon rêve”, vous l’adoptez et vous en faites ce que vous voulez », invite Saadia. Rencontrée à Tunis, l’hôtesse de l’air à la retraite, qui n’est pas dépourvue d’humour voire de raillerie, brosse l’état des lieux du racisme dans son pays, où vivent des Afro Tunisiens comme elle et où s’installent des migrants subsahariens. Un état des lieux sans concession, au regard auquel émergent des points communs avec le vécu d’Afro descendants en Belgique.
Comment voulez-vous être présentée ?
Saadia Mosbah : Je suis citoyenne tunisienne. Et depuis octobre 2018, je suis citoyenne tunisienne à part entière. Ma deuxième naissance, je la dois à l’adoption de la loi n° 50-2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Depuis ce moment, je me sens égale à tous les Tunisiens et Tunisiennes parce que, en tant que victime de racisme, je pourrais désormais porter plainte auprès du procureur. Ce qui n’était pas le cas avant cette loi.
C’est en 2013 que Mnemty a commencé le plaidoyer pour une loi contre le racisme, avant d’être rejointe par d’autres associations. Et là encore, j’ai un rêve : j’aimerais que beaucoup plus d’associations luttent contre la discrimination raciale en Tunisie. Malheureusement, à part Mnemty, il n’en existe qu’une seule, appelée Soutien aux minorités, et qui s’occupe spécifiquement de la lutte contre la discrimination religieuse, en particulier contre les juifs tunisiens. Cette association a élargi depuis peu son champ d’action à la discrimination raciale parce que, il faut le dire, c’est un sujet porteur auprès des bailleurs de fonds européens.
Après 5 ans de plaidoyer, une loi a donc été votée. Si elle reconnaît le statut de victime à la personne agressée, elle reste cependant une toute petite loi car les moyens n’ont pas suivi, notamment pour la prise en charge psychologique. Sur ce point, l’Etat est dans le déni. La situation est encore plus compliquée dans le cas des victimes subsahariennes. Souvent en situation irrégulière, ces personnes ont peur de porter plainte. En plus, beaucoup ne parlent pas arabe. Bien qu’elles aient droit à un interprète assermenté comme stipulé dans la loi, il n’en est rien dans les faits. Bref, cette loi est à décaper et à revoir.
Une Afro descendante belge témoignait dans Imag [1] : « Chaque niveau de la société [belge] me renvoie au fait que je suis une personne noire », concernant entre autres l’accès au logement, l’enseignement, la recherche d’emploi, les contrôles de police, et même dans le cadre des loisirs. Qu’en est-il en Tunisie ? Quel est l’état des lieux du racisme anti noir ?
Saadia Mosbah : Ce témoignage belge vaut pour la société tunisienne, excepté pour le logement qui n’est pas un problème chez nous : les Afro Tunisiens ont accès au marché de location. Et depuis l’arrivée de la Banque africaine en 2003, les Tunisiens ont l’habitude de rencontrer des Noirs qui peuvent se permettre de vivre dans les quartiers huppés.
Néanmoins, aux yeux des Tunisiens, être Noir c’est être uniquement descendant d’esclaves. Nous ne sommes pas acceptés en tant qu’autochtones d’Afrique du Nord, non seulement en Tunisie, mais également en Algérie et au Maroc. De la traite transsaharienne aux migrations actuelles, l’histoire a fait de la Tunisie la dernière étape avant l’Europe. Nous sommes à 40 minutes de l’Italie. Pourtant, la Tunisie n’est pas qu’un pays de transit : les migrants subsahariens qui ne passent pas la porte de l’Europe s’installent ici.
Dans l’imaginaire collectif tunisien, le Noir est quelqu’un de très fort physiquement qui peut donc travailler pendant de longues heures sans se fatiguer ; d’où l’avantage d’avoir un Noir pour travailler la terre ou à la maison. J’entends dire, entre autres par des étudiants universitaires : « C’est à cause de ces gens-là qu’on n’a plus de pain. C’est à cause de ces gens-là qu’on a eu le covid». Le Noir fait peur, il sent mauvais, il mange les enfants pas sages. Les consignes des parents à leurs enfants sont aussi claires que sincères : «Ne jouez pas avec les Noirs, ils ne sont pas comme nous». Dans le sud tunisien, là où est né mon père, on en est toujours à se classer selon la couleur de peau – les gens libres et les esclaves… qu’on enterrera dans des cimetières séparés, comme à Djerba.
Des gens ne peuvent pas comprendre mon identité ou peut-être ne veulent pas… Certes, ma manière de m’habiller 34 n’est pas tunisienne, mes tresses non plus. Ça me semble drôle qu’on me souhaite la bienvenue en Tunisie quand je me balade dans la rue, comme si j’étais de passage. Mais ce qui me fait mal c’est que, malgré qu’on m’entende parler tunisien, on persistera à me souhaiter la bienvenue en Tunisie.
Pour les Subsahariens nouveaux arrivants, ça se passe mal aussi. Une première barrière : ils ne parlent pas arabe – et le Tunisien ne parle plus français. Il y a donc un problème de communication. La religion est une deuxième barrière, les Tunisiens se montrant un peu plus conciliants avec les migrants musulmans qu’avec les autres. Les Noirs ne sont donc pas les bienvenus. Or, ce sont les mêmes qui élèvent les enfants à demeure ! Comment des parents peuventils confier leurs enfants à des nounous qu’ils méprisent, frappent, ne paient pas ? C’est quoi cette schizophrénie !
Pour arriver à mettre l’histoire de l’esclavage ou du racisme sur la table, il faudra passer par des étapes préalables que sont la reconnaissance et le pardon. On ne peut pas s’assoir à une même table sans avoir franchi au moins ces deux étapes. La question des réparations viendra ensuite, et je ne peux l’envisager que sous la forme intellectuelle. Il ne s’agirait pas de mettre une deuxième fois la Tunisie à genoux, après les effets des réparations que le gouvernement a dû verser aux victimes du régime de Ben Ali. Aujourd’hui, si les Tunisiens ont faim, c’est aussi en partie à cause des sommes faramineuses englouties dans ces réparations.
Existe-t-il des recherches sociologiques de référence sur les Afro Tunisiens ?
Saadia Mosbah : Des études sociologiques existent… entre 5 et 18 lignes concernent les Afro Tunisiens ! Pour combler ce vide, nous sommes occupés à finaliser une étude empirique auprès de 250 témoins à travers le pays, soit 85 h d’enregistrement. C’est la première étude menée par des Noirs eux-mêmes, avec la contribution du sociologue Abdessatar Sahbani. Elle est intitulée « Le vécu noir » et sera publiée en arabe, français et anglais.
Entre autres, nous avons demandé aux témoins s’il existait, selon eux, une conscience noire en Tunisie. Nous avons vite trouvé qu’il n’y avait pas de base communautaire solide ni de reconnaissance du passé esclavagiste. L’amnésie règne au sein même de la communauté ; des grands-parents taisent qu’ils ont été esclaves et ne transmettent rien à leurs petits-enfants, d’abord parce qu’ils ont intégré une honte (puisqu’on leur a toujours répété que c’était honteux), ensuite parce qu’ils souhaitent se fondre dans la société.
Dans ce contexte, où en est le travail de déconstruction des stéréotypes à l’école, dans les médias, dans la société civile en Tunisie ?
Saadia Mosbah : Normalement, ce travail devrait être entrepris par l’Etat. Les politiciens veulent-ils aller dans ce sens ? Le vivre ensemble est-il un projet de société ? Estil réalisable ? Y pense-t-on ?… Il faut bien admettre que la question raciale n’est pas encore mise sérieusement sur la table. On est très content de proclamer être le premier pays à avoir aboli l’esclavage, avant la France et les Etats-Unis. Certes, mais qu’est-ce qui a changé dans la vie des Tunisiens noirs ? Ils sont passés de l’esclavage à la servitude – et ça arrange tout le monde. Ni prise de conscience, ni débat.
Si vous sortez dans la rue maintenant et que vous dites « 23 janvier 1846 », peu de Tunisiens seront capables de vous répondre que c’est la date d’abolition de l’esclavage. Alors que ce jour est officiellement reconnu depuis 2019, il ne figure toujours pas dans les manuels scolaires. Au cours de notre recherche, nous avons trouvé, dans les livres scolaires tunisiens, que le seul Noir iconographiquement présent s’appelle Mamadou [2]. N’est-ce pas un message pour signifier aux petits lecteurs que les Noirs ne peuvent pas être des nôtres, qu’ils ne peuvent être qu’étrangers ?
Lorsque vous vous exprimez pour déconstruire ces stéréotypes, considérez-vous que votre parole porte ou qu’elle reste à la marge ?
Saadia Mosbah : Je vais vous faire une annonce extraordinaire : nous sommes à la marge tous les jours, et sur le podium dès qu’il se passe une catastrophe ou un événement phare, telle la Journée mondiale contre toutes les formes de discrimination. Ce jour-là, la presse nous donne l’impression qu’elle nous écoute, que notre parole compte. Et en même temps, on nous demande de répondre en 2 ou 3 minutes. Je ne marchande pas. J’ai décidé de ne plus caresser dans le sens du poil. Parce que j’ai compris une chose : seul l’affrontement produit des effets pour notre cause. A 20 ans, j’aurais accepté des concessions. Mais à 62 ans, je ne souhaite plus mâcher mes mots, pourvu que tout se passe dans le respect de mes interlocuteurs. Je ne vais pas encore vivre 62 ans pour voir ce qui changera dans notre société. Autant avancer et déblayer la route pour les générations suivantes ! Je préfère recevoir les réactions négatives à la place de mon fils et des jeunes. Cela dit, ce matin, lors de l’élaboration de la feuille de route des jeunes d’AWLN (African Women Leaders Network), j’étais fière d’entendre s’exprimer une des jeunes membres de Mnemty. J’étais fière parce qu’elle a bien conscience de cet affrontement ; elle choisit des mots qui percutent, quitte à faire mal.
Les défis nous maintiennent en vie. On ne m’a pas appris à plier, ni à pleurer. Nous utilisons très peu le mot victime. Je ressemble peut-être à un de ces palmiers qui poussent dans le sud et dont beaucoup sont morts. Ils sont morts debout. Et vous ne vous en apercevez pas.
Une image pour le moins troublante… Mais avant de nous quitter, racontez-nous un défi récent que vous avez relevé à Mnemty !
Saadia Mosbah : C’est une affaire qui touche un étudiant subsaharien jeté en prison pour vol de bijoux. Il venait d’arriver à Tunis, sans contacts, sans jamais avoir traversé le quartier où le vol a été commis. Nous l’avons soutenu. Ce qui m’a réjoui c’est que le juge a fait l’effort de l’écouter en présence d’un traducteur assermenté, comme le prévoit la loi 50. Ce jeune homme a été relaxé – il a quand même passé deux mois en prison qui l’ont cassé. Néanmoins, ce dénouement m’émeut et me donne beaucoup d’espoir : le message est passé qu’on peut défendre ses droits même quand on n’est pas dans son propre pays.
Propos recueillis par Nathalie Caprioli
[1] Extrait de l’entretien avec Emmanuelle Nsunda, in Imag n° 356 mars-avril 2021, “Mouvances décoloniales. Rébellion des oubliés”, p. 12.
[2] Prénom d’Afrique de l’Ouest qui a pour racine le prénom arabe Mohamed.
A voir
L’exil vu de Tunisie, avec notamment la rencontre entre un hébergeur de migrants en Belgique et un pêcheur tunisien qui s’efforce de donner une sépulture aux corps rejetés encore et encore par la mer. Saadia Mosbah compte parmi les nombreuses personnes ressources et témoins de ce documentaire. Le film de Pierre Schonbrodt, produit par le Centre d’Action Laïque (2022, 32 min.), sera projeté en septembre 2022 à l’Espace Magh.