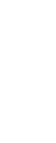
#361 - mars/avril 2022
Fabrique de liens
Mémoire familiale et histoire des migrants
#361 - mars/avril 2022
« Je viens de leur histoire »
Licenciée en histoire, Lina Soualem est aussi réalisatrice. Durant trois années, elle a filmé ses grands-parents Aïcha et Mabrouck. Dans son travail, il est autant question de transmission de leur histoire d’Algériens exilés en Auvergne dans les années 1960, que de processus de construction d’elle-même au regard de l’héritage familial. Mais plus qu’un documentaire familial et intimiste, “Leur Algérie” a aussi une portée sociale pour trois générations de Franco-Algériens.
En recueillant le récit de vie de vos grands-parents, avez-vous trouvé une place pour vous dans leur propre histoire ?
Lina Soualem : Mon film s’appelle “Leur Algérie” car c’est à travers la perception de l’Algérie de mes grands-parents – ce qui leur est resté et ce qu’ils ont dû laisser – que j’ai pu aussi trouver la mienne et les liens que je pouvais créer avec l’Algérie aujourd’hui. J’avais besoin de savoir comment mes grands-parents avaient vécu la colonisation, la guerre d’indépendance, l’exil en France pour comprendre comment je me plaçais entre ces histoires et trouver ma place dans le pays où je suis née qui, de surcroît, a tendance à traiter cette histoire comme étrangère. On qualifie souvent les immigrés algériens d’étrangers alors qu’ils portent 132 ans de colonisation française. Et malgré tout, ils restent invisibilisés dans cette histoire commune.
Face aux silences qui régnaient autour de leur vécu, j’ai toujours eu l’impression que mes grands-parents étaient sans histoire, alors qu’ils étaient juste taiseux – non pas par tempérament, mais parce qu’ils ont été mis sous silence par les histoires collectives qu’ils ont partagées. Au-delà d’eux-mêmes, c’est toute une génération d’Algériens qui était discrète – à l’instar de beaucoup d’autres déracinés venus d’ailleurs qui ont aussi traversé des guerres et des épisodes de colonisation.
La première fois que je suis allée en Algérie, ce fut dans un cadre universitaire et non familial. J’ai réalisé alors le décalage entre ce que j’apprenais et le silence de mes grands-parents. J’ignorais à quel point mon histoire intime se mêlait à cette histoire collective que je découvrais très tardivement, vu qu’elle n’était pas enseignée à l’école en France. J’ai dû faire des études d’histoire pour la connaître.
En quoi votre identité s’est-elle enrichie ou frottée à ce que vous avez appris sur le “roman familial”, de la trajectoire migratoire de vos grands-parents à l’histoire de votre père ?
Lina Soualem : Pendant le tournage du film, il était important pour moi de pouvoir redécouvrir la complexité de cette histoire puisqu’elle est toujours perçue de façon binaire : “Si tu es algérien tu n’es pas français; si tu es français tu n’es pas algérien”. En France, on demande de faire des choix, comme si on ne pouvait pas exister pleinement dans ses multiples identités. J’ai toujours trouvé cette injonction assez violente parce que j’avais l’impression que je devais choisir pour faire plaisir aux autres sans pouvoir être pleinement ce que je suis. Or, découvrir la complexité de la relation de mes grands-parents et de mon père à leur identité m’a permis de m’affirmer dans mon identité multiple. Ça m’a permis aussi de comprendre que nous avons grandi dans un espace intermédiaire dans lequel je me sens bien aujourd’hui parce que j’ai pu explorer et interpréter le silence. J’ai saisi que ce silence traduisait la douleur du déracinement et cachait moins des secrets qu’une souffrance J’ai compris pourquoi ils sont venus et pourquoi je suis née ici. Je viens de leur histoire. Faire ce film m’a permis de me réancrer et de trouver une forme d’apaisement.
Par quelle mécanique ce silence, qui s’explique plus par l’histoire politique que par le caractère des gens, s’est-il mis en place ?
Lina Soualem: Toute une génération a grandi dans “la discrétion”, pour reprendre le titre du roman de Faïza Guène. Ils n’ont pas transmis leur histoire afin, peut-être, de ne pas faire souffrir leurs enfants, vu que c’est une histoire d’exploitation, d’humiliation, de dépossession d’identité, de dépossession matérielle puisque beaucoup ont perdu leurs terres auxquelles ils n’avaient plus accès en raison de la colonisation. Je pense qu’ils sont entrés dans ce piège de ne pas transmettre pour ne pas infliger ces traumas et parce qu’il fallait se faire discrets pour appartenir à la société française.
Mais finalement, des émotions se transmettent malgré tout, même à travers le silence. Pour ma part, le peu que je percevais était souvent significatif. On entend par exemple une grand-mère raconter: “Quand j’étais petite, mon oncle s’est fait tuer. Il était avec ses moutons. Lorsqu’un soldat français l’a appelé, il ne s’est pas retourné parce qu’il était sourd. Et ils l’ont tué”. Les seuls commentaires consistaient à minimiser: “Ah oui… c’est une anecdote”. Pourtant ces anecdotes font aussi partie d’une histoire qu’on a besoin de connaître. Ce silence intime au sein des familles s’ajoute au silence officiel, du fait que l’histoire de la conquête de 1830, de la colonisation française et de la guerre est taboue, polémique, controversée, et le devoir de mémoire n’est pas du tout atteint.
On évoque souvent l’histoire de l’Algérie en commençant par la guerre d’Algérie – c’est-à-dire par la fin. Or, ce n’est pas la meilleure manière de raconter en commençant par la fin parce qu’on zappe les mécanismes d’oppression et de répression mis en place durant un siècle. Face aux impasses du double silence intime et officiel, il est très difficile de se construire et de trouver sa place dans la société. Soit on fait abstraction – ce qui est demandé dans la société française. Soit on éprouve le besoin de fouiller la mémoire pour échapper à des tourments et tenter de trouver sa place. Cette recherche vise à transformer le manque de reconnaissance en quelque chose de positif qui pourrait nous aider à aller vers ceux qui connaissent leur histoire. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons nous construire que par la reconnaissance de l’autre et par la reconnaissance de son identité, de son histoire, de sa mémoire.
Dans votre film, vous touchez des points hyper sensibles et douloureux pour vos grands-parents. Quelle limite vous êtes-vous autorisée?
Lina Soualem: Je ne me suis pas censurée en leur posant mes questions parce que l’objectif vital de capturer leur mémoire était plus fort que ma timidité ou ma crainte de la réponse qui allait suivre. Mais comme une certaine pudeur m’a été transmise par ma famille, je n’aurais pas pu dépasser des bornes. Aussi je suis allée à la limite de ce que j’avais le courage de poser comme questions. Mais en même temps, je sens que j’ai posé toutes les questions que je souhaitais. Parfois, quand nous approchions de thèmes trop intimes, je n’ai pas eu envie de creuser davantage parce que je me rendais compte que si ma grand-mère ou mon grand-père ne me répondaient pas ou ne pouvaient pas me répondre, c’est parce qu’eux-mêmes ne s’étaient jamais autorisés à formuler ces choses. Et je ne voulais pas les formuler à leur place; l’exercice est d’autant plus impossible à réaliser que je porte un regard différent et que j’ai reçu une éducation contemporaine.
J’ai pu aller jusqu’au bout en gardant cet objectif de capturer leur mémoire et de la retransmettre aussitôt à travers le film. Depuis le départ de mon projet, j’avais cette urgence de capturer leur mémoire parce que j’avais une énorme crainte de leur disparition sans qu’ils puissent me transmettre leur histoire. J’avais l’impression que si ça arrivait, je perdrais une partie de moi-même que je ne pourrais jamais retrouver. Et dans l’élan, je voulais absolument la capturer et la retransmettre aussitôt parce que je sentais que ce n’était pas que mon histoire mais aussi une histoire commune que d’autres n’auraient peut-être pas la possibilité d’aller chercher. Soit parce qu’ils ont déjà perdu leurs grands-parents, soit parce que c’est une entreprise trop compliquée dans leur contexte familial – il existe des familles où on ne peut pas poser ce type de questions. Et puis, faire un film n’est pas donné à tout le monde; c’est quand même un privilège que de pouvoir passer trois ans à filmer ses grands-parents et de réaliser un film.
Au début du film, votre grand-mère vous lance: “On n’a jamais parlé, c’est pas maintenant qu’on va commencer. (…) Tu demandes trop!”
Lina Soualem: Oui, je demande trop quand nous touchons à l’intime ou aux non-dit entre elle et mon grand-père. On comprend que ce silence vient d’une histoire qui a affecté des personnes dans les recoins les plus intimes, dans les relations de couple, dans les relations familiales. Et c’est en ça que les histoires intimes s’imbriquent énormément avec l’histoire collective. C’est précisément ce que je voulais faire ressortir dans le film, sans savoir si j’allais réussir. En commençant, je n’étais pas sûre que, par leur histoire singulière, une porte pourrait s’ouvrir sur l’histoire collective. Mais j’avais cet instinct que j’allais y arriver.
Ce fut aussi tout le travail avec la monteuse du film de faire ressurgir l’indicible, parce que j’ai voulu briser les silences en pensant que j’allais avoir des réponses concrètes à mes questions. J’ai commencé comme une petite fille qui avait plein de questions et voulait absolument avoir des réponses. J’ai rapidement compris que ce silence ne cachait pas des secrets mais la douleur du déracinement et de l’exil. Et finalement, j’ai accepté ce silence. J’ai voulu le comprendre et l’explorer et voir comment il s’exprimait dans les corps, comment il se transmettait, ce qu’il signifiait. Il a fini par raconter quelque chose en l’observant et en prenant mon temps. C’est en cela que réside le défi du montage: pouvoir faire parler le silence.
Propos recueillis par Nathalie Caprioli