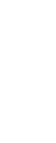
#369 - novembre/decembre 2023
Une matière vivante !
Archives de l’histoire coloniale
#369 - novembre/decembre 2023
Interpréter les silences
Docteur en histoire de l’EHESS à Paris, Amzat Boukari-Yabara a pour sujet de prédilection l’histoire engagée des indépendances et du panafricanisme. Les archives de l’histoire coloniale, il connait ! Il livre ici une analyse critique de la production de ces archives jusqu’à leur traitement.
Selon vous, comment parvenir à produire un nouveau narratif de l’histoire coloniale qui ne parte pas uniquement du point de vue occidental?
Amzat Boukari-Yabara : L’administration coloniale a créé des documents pour contrôler les populations, et pour informer les pouvoirs exécutifs des métropoles, voire l’opinion publique européenne, sur les actions qu’elle menait en Afrique. L’archive coloniale est donc une sélection de l’information puisque ceux qui la produisaient discriminaient l’information des colonisés, créant de fait des archives asymétriques où le colonisé est invisibilisé puisqu’on a considéré que son actualité n’avait pas à être archivée.
Du coup, il y a une déperdition et une silenciation de l’histoire du colonisé et de son point de vue. C’est face à ce constat que la question des sources orales est réapparue. En général, celles-ci n’ont pas été consignées par écrit parce qu’elles n’étaient pas utiles au pouvoir colonial. Or, les étudier permet de changer le point de vue et participe à décoloniser les archives coloniales.
Les sources orales sont souvent critiquées : elles ne seraient pas fiables vu qu’elles reposent beaucoup sur la mémoire, par définition limitée. Ce sont pourtant des sources comme d’autres, qui nécessitent un même travail de contextualisation et de croisement des informations avant de mesurer ce qu’on peut en retirer. Cela dit, l’écrit aussi peut être lacunaire et biaisé. Tout dépend de l’histoire qu’on veut écrire. Une histoire officielle ou une histoire populaire? Attend-on de l’archive qu’elle nous donne une vérité historique ou du sens historique? La vérité et le sens sont deux choses différentes. Une archive peut révéler une vérité historique qui n’a aucun sens. Cela nous renvoie par exemple aux archives de propagande, construites pour fabriquer l’opinion : elles produisent ainsi une vérité sur la mission civilisatrice qui ne fait pas sens par rapport à la politique coloniale.
La vérité sur la colonisation, on ne pourra la connaître qu’à travers les colonisés… invisibilisés, puisque l’archive avait notamment pour vocation de convaincre l’Europe que la colonisation était positive.
Les historiens se doivent de convoquer une diversité de sources: orales, matérielles, artistiques, économiques, y compris les sources des compagnies privées qui, malgré leur accès malaisé, permettront de toucher par exemple à l’histoire du capitalisme ou des pratiques d’esclavage au 20e siècle – une autre façon de contrebalancer l’histoire coloniale officielle.
Principalement dans les années 1970, s’est développée l’histoire des résistances africaines. Pour ce faire, on a étudié comment l’archive coloniale s’est réajustée par rapport aux résistances anti coloniales et aux politiques de répression. L’histoire de la fiscalité coloniale nous donne ainsi pas mal d’informations sur le refus de payer l’impôt comme acte de résistance.
Les silences dans les archives sont des faits qui n’ont pas accédé au statut d’archive. A l’historien de les interpréter! Que révèlent-ils? Quand, subitement, aucune archive ne mentionne telle révolte dans tel village, on se dit qu’il est impossible que l’administration coloniale n’en ait pas été informée mais qu’il y a eu, à un moment donné, un phénomène de censure. Il faut alors creuser la question: c’est tout un travail d’interprétation et d’enquête auquel des historiens locaux, forts d’une connaissance de faits par la tradition orale, peuvent aussi prendre part. A cela s’ajoutent les journaux anticolonialistes ou simplement locaux qui abordaient déjà ces questions, même s’ils étaient peu nombreux. Des biographies d’intellectuels africains et des sources littéraires apportent également des explications sur la façon dont ils ont vécu la colonisation.
Pour écrire l’histoire culturelle, sociale et politique, il est important d’inclure la dimension matérielle des sources, notamment les œuvres d’art et les objets. La présence d’autant d’objets africains ici résulte, selon le point de vue, d’une conquête militaire et politique, ou d’une résistance vaincue. L’enjeu actuel n’est pas tant la restitution de ces objets que d’écrire l’histoire qui se cache derrière ces objets.
Bref, il ne peut pas y avoir d’histoire commune s’il n’y a pas une réflexion sur les archives. On est obligé d’écrire cette histoire commune de manière rétrospective, parce que le principe de la colonisation était de tout faire pour ne partager aucune histoire commune. Preuve en est la séparation asymétrique des archives au moment des indépendances.
Que voulez-vous dire ?
Amzat Boukari-Yabara : Au moment des indépendances, on a assisté à un marché des archives. Concernant les archives coloniales françaises1, elles ont été partagées entre la France et chacune de ses anciennes colonies sous des modalités différentes. Si on prend le cas des archives de l’Afrique équatoriale française – c’est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique – une partie a été gardée en France aux Archives nationales d’outre-mer d’Aix-en-Provence. Et l’autre partie a été divisée entre Pointe-Noire (l’ancienne capitale coloniale du Moyen-Congo) et Brazzaville (l’actuelle capitale de la République du Congo). Un historien en Afrique qui travaille sur cette période doit d’abord identifier comment les archives ont été découpées et éclatées au moment des indépendances. C’est assez compliqué parce que les catalogues sont rarement précis sur la description des fonds d’archives. C’est seulement en accédant au matériel qu’on peut se rendre compte du contenu réel.
Outre le partage asymétrique des archives, il y a l’idée que l’histoire du Sénégal ou de la République démocratique du Congo (RDC) par exemple ne débuterait qu’en 1960 – ce qui n’a pas de sens. L’histoire ne s’arrête pas, ne recommence pas; elle continue. La colonisation rappelle qu’avant elle, il y avait déjà des indépendances. On ne peut donc pas prétendre que l’histoire du Sénégal ou de la RDC commence par les indépendances en 1960.
A partir de 1960, le défi a été en revanche de se construire en tant que nation, mais sans archives ni cadre historique autre que celui de la colonisation. C’est pour cette raison que, dans les années 1960, on observe un boom où toutes les histoires doivent s’écrire: il faut expliquer qu’on a une grande histoire! L’exercice s’opère dans un contexte où les sciences humaines et sociales n’ont pas été décolonisées, ce qui pose des soucis puisque les sciences humaines qui ont accompagné la colonisation avaient pour particularité d’avoir été productrices de relations antisociales, dans la mesure où elles avaient pour objet de diviser, d’opposer, de contrôler, de hiérarchiser, de créer des tribus, alors qu’elles sont censées expliquer comment on fait société ou collectivité. C’est cette question qui arrive aujourd’hui : décoloniser l’université, les bibliographies, les historiographies, c’est démanteler et repenser les cadres du 19e siècle qui n’ont plus de raison d’être au 21e siècle. L’ignorance de l’opinion publique européenne à ce propos est notamment entretenue par la difficulté pour des historiens africains d’écrire cette histoire de leur point de vue d’anciens colonisés. Pour interpeller cette opinion européenne, il s’agit d’étudier la fabrique de la mémoire, de l’oubli, du déni à travers les archives dont certaines ont dénoncé des crimes – on ne pouvait pas dire qu’on ne savait pas.
A propos de l’ambition d’écrire une histoire commune, comment évaluez-vous l’état d’avancement de la chose ?
Amzat Boukari-Yabara : Nous en sommes encore loin, même si un projet comme l’Histoire générale de l’Afrique par l’UNESCO en a montré la possibilité. La relation demeure asymétrique. Un premier défi serait que, du côté africain, on ait connaissance aussi de l’histoire de France ou de Belgique, et qu’on ait potentiellement une capacité à écrire cette histoire-là du point de vue de la colonie. Je pense en effet qu’on ne peut pas écrire une histoire commune si on ne maîtrise pas, à peu près au même niveau, et l’histoire de l’Afrique et l’histoire de l’Europe. Dans quelle mesure des historiens africains peuvent-ils être et doivent-ils être légitimes pour écrire l’histoire de l’Europe, en sachant que n’importe quel historien européen ne se pose pas la question de sa légitimité à écrire l’histoire du Congo ou de l’Afrique – histoire extravertie puisqu’elle est écrite de l’extérieur et que ses principales sources sont à l’extérieur?
Je n’ai pas le sentiment qu’on soit dans une volonté de corriger cette asymétrie, à laquelle s’ajoute une asymétrie professionnelle: pour un historien africain, on doit compter plusieurs dizaines d’historiens européens.
… et de ces historiens africains, combien sont-ils formés en Occident, comme vous?
Amzat Boukari-Yabara : En Afrique, il y a des bonnes facultés d’histoire. Les étudiants formés en dehors de l’Afrique représentent une minorité.
Aujourd’hui, il existe un cadre africain “compétitif” dans un marché de l’histoire globale, même s’il n’est pas doté des mêmes moyens que les laboratoires européens, américains ou du Golfe. Je pense à la communauté d’historiens panafricaine CODESRIA: le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, basé au Sénégal. Par ailleurs, en novembre dernier à Philadelphie, j’ai participé à la 65e édition de l’African Studies Association. C’est le plus grand rassemblement de chercheurs qui travaillent sur l’Afrique. Depuis 65 ans, il a toujours eu lieu aux Etats-Unis, jamais en Afrique. Il a fallu la pandémie du Covid pour qu’une réunion s’organise à distance, permettant ainsi la participation de chercheurs africains. Récemment, en réaction, des chercheurs africains ont décidé de créer son équivalent mais en Afrique, afin de souligner la nécessité de venir en Afrique pour écrire l’histoire de l’Afrique. C’est en effet essentiel pour comprendre les questions qui se posent dans les sociétés africaines. Si on écrit une histoire du Congo depuis la Belgique juste à partir des archives, on ne parviendra pas à tenir compte des questions concrètes et précises qui traversent la société.
Il y a histoire commune quand il y a enjeu commun. Et je ne suis pas certain aujourd’hui qu’il y ait des enjeux communs. Parce que tous les conflits et litiges n’ont pas été réglés. Existe-t-il une histoire commune de Patrice Lumumba entre la Belgique et le Congo2 ? C’est dans ce contexte que des communautés d’historiens entreprennent des Congo Studies, des Congo Network, etc., et produisent une histoire critique. Mais à quel point est-elle considérée par les pouvoirs publics comme étant une histoire commune? C’est toute la question des tensions entre l’histoire officielle et l’histoire critique.
Propos recueillis par Nathalie Caprioli
[1] Sur la répartition des archives coloniales belges, lire l’interview
de Bérengère Piret.
[2] Lire « Lumumba, les mineurs et le silence » de Quentin Noirfalisse, en pages 22-26 de ce dossier.